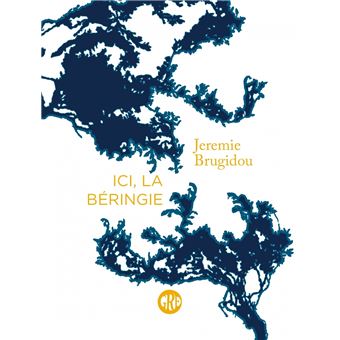Ici la Béringie
Publié le jeudi 14 avril 2022
Une expédition spatio-temporelle dans le détroit de Béring
Le livre s’ouvre sur une carte. La Béringie regroupe le détroit de Béring et ses deux morceaux d’un continent autrefois réuni, d’un côté la Russie et son Béringia Park, de l’autre les Etats-Unis et son homologue, au milieu, les iles Diomède, la grande et la petite. Le détroit en question marque le passage de la mer de Béring à la mer des Tchouktches qui va vers l’Océan Arctique. Attention à l’orthographe ! En tout cas, cette fois, en quelques lignes, nous partons dans un autre monde, ou, plutôt plusieurs en parallèle.
Nous sommes un peu plus loin dans ce siècle. L’auteur -Jérémie Brugidou né à Bruxelles en 1988, auteur-cinéaste-chercheur - anticipe l’existence d’une voie navigable dans l’Arctique et même la construction d’un pont géant entre les deux rives qui « scellent » à nouveau la Russie et l’Amérique. Une compagnie, la Gozok Sustainable Industries, a lancé ses équipes sur ses nouveaux territoires. Bâtisseurs, chercheurs et populations autochtones s’affrontent en sourdine. Les glaces de ce pôle Nord fondent. Des traces de vie antérieures remontent à la surface. Nous suivons Jeanne, une jeune scientifique, venue diriger un chantier de paléoanthropologie. Elle est aussi à la recherche de son frère disparu au même endroit, quelques temps plus tôt, parti, lui, sur les traces d’une expédition d’un chercheur américain et de ses deux compagnons d’exploration – un trappeur d’Alaska et un mécanicien de la Sibérie.
Jeanne reprend le carnet perdu par son frère avant qu’il ne disparaisse. Dans ce carnet, il y a une évocation du journal de Steller, un autre savant qui accompagna en 1741 le commandant Béring lequel laissera son nom dans l’histoire avant de disparaître à son tour. Est-ce la troisième histoire que nous allons suivre ? Non. Nous allons encore remonter le temps de quelques milliers d’années et suivre la fuite éperdue de Sélhézé, jeune femme recouverte d’une peau de loup, envoyée pas sa tribu chercher de nouvelles terres parce que la mer monte inexorablement et inonde les territoires de chasse et de cueillette de ces premiers humains.
Voilà bien ces trois histoires en parallèle, ces trois mondes dont le lecteur suit les péripéties. Les chapitres s’enchaînent. Cela commence comme un roman d’aventure avant de devenir un roman à clé parsemé de termes scientifique. Il faut chercher les définitions pour le permafrost omniprésent (ou pergélisol, terre gelée), le Pléistocène (dernière époque glaciaire), la palynologie (étude des grains de pollen et des spores, actuels ou fossiles), etc. C’est le récit du réchauffement climatique, des mutations de la géologie, de la flore et des espèces animales ou humaines. Cela parle forcément aux lecteurs d’aujourd’hui.
Mais ce récit se transforme en long poème épique lorsqu’il évoque les tourments des populations primitives composées des Qui-collectent, des Tombent-viande, des Mettent-à-mort, des Qui-Transforment-la-Sensation, les Médecines (des sorciers ?) … Le feu danse à l’entrée des grottes, le vent souffle, fait ployer les saules et les bouleaux (encore des arbres de la Sibérie d’aujourd’hui), les graines volent, les pollens s’enfuient, les eaux montent, la glace recouvre les ossements des mammouths et des rhinocéros laineux, des hommes et des femmes luttent, l’époque les marque durement. Comment cette transmutation va-t-elle s’accomplir. L’auteur rêve, imagine ce monde disparu… Les herbiers recueillis par des générations de scientifiques livreront-ils tous leurs secrets ? Auront-ils seulement le temps alors que l’activité humaine ne cesse de se déployer et réinventer les lieux qu’elle occupe ? Il ne faut pas chercher dans ces pages d’explications définitives. Ce n’est pas une démonstration. C’est bien un fascinant et virtuose voyage.