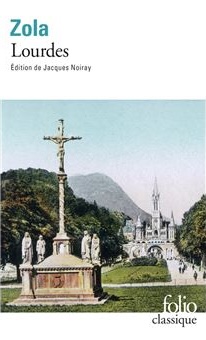Paris
Publié le mardi 07 octobre 2025
Tous les chemins mènent à Paris
Les Rougon-Macquart nous avaient habitués au Zola naturaliste. Tous les personnages de cette grande famille héritent de destins que tout explique, à la fois dictés par la géographies, les rencontres plus ou moins fortuites, les inclinations, les unions, et les enfants qui en naîtront verront leurs existences bien dépendantes de toutes ces circonstances. Une démonstration puissante mais presque (trop) répétitive. Dans les Trois villes, la dernière grande oeuvre de Zola qui disparaîtra tragiquement en 1902, au contraire, l'écrivain surprend par son lyrisme, une écriture flamboyante pour décrire une époque contrastée, les situations précaires des ouvriers comme des petits employés, la dureté d'une ville que les fumées noires des cheminées des usines recouvrent, les intrigues qui depuis la Chambre des députés défont les ministères, l'affrontement des propriétaires de journaux, une activité en plein développement, la froide indifférence d'une bourgeoisie qui délègue sa charité chrétienne à un clergé débordé... Zola, grand amateur de vélo, met aussi en scène un industriel du cycle soucieux de la condition de ses ouvriers, de leur santé, aux accents presque saint-simoniens.
Le roman se déroule beaucoup à Montmartre mais pas seulement. L'auteur nous transporte à Auteuil, à Neuilly, dans le bois de Boulogne et bien sûr au coeur des quartiers du centre de Paris dans les hôtels particuliers où aristocrates finissant et bourgeois en pleine ascension se mesurent d'une réception à l'autre. Des hommes, des femmes se croisent, se cherchent, se trouvent, se séparent. Il y est beaucoup question aussi de la condition des femmes, de leur liberté quelque soit leur milieu. Sur fond de luttes sociales et de foi bousculée, l'amour de Dieu n'est pas le seul à triompher... L'auteur entraîne son héros - et sa famille - dans un tourbillon d'évènements. Autant de rebondissements qui tiennent le lecteur en haleine.
Impossible enfin de ne pas rapprocher cette époque passée - la toute fin du XIXe - et la nôtre. A lire ci-après deux portraits saisissants. Toute ressemblance avec des personnages existants ne peut-être que pure coïncidence...
Extrait
« Ensuite, ce fut Monferrand, le ministre de l'Intérieur, […], lui, au contraire, âgé de cinquante ans, était court et gros, l'air souriant et paterne; mais sa face ronde, un peu commune, entourée d'un collier de barbe brune encore, avait des dessous de vive intelligence. On sentait l'homme de gouvernement, des mains aptes aux rudes besognes, qui jamais ne lâchaient la proie. Ancien maire de Tulle, il venait de la Corrèze, où il possédait une grande propriété. C'était sûrement une force en marche, dont les observateurs suivaient avec inquiétude la montée constante. Il parlait simplement, avec une tranquillité, une puissance de conviction extraordinaires. Sans ambition apparente, d'ailleurs, il affectait un complet désintéressement, sous lequel grondaient les plus furieux appétits. »
————————
« Et puis, ce fut encore un des personnages du drame qui allait se jouer, le député Vignon, dont l'entrée agita les groupes. Les deux ministres le regardèrent, tandis que lui, tout de suite très entouré, leur souriait de loin.
Il n’avait pas trente-six ans et de taille moyenne, très blond, avec une belle barbe blonde, qu'il soignait. Parisien, ayant fait un chemin rapide dans l'Administration, un moment préfet à Bordeaux, il était maintenant la jeunesse, l'avenir à la Chambre, ayant compris qu'il fallait en politique un nouveau personnel, pour accomplir les plus pressées des réformes indispensables; et, très ambitieux, très intelligent, sachant beaucoup de choses, il avait un programme, dont il était parfaitement capable de tenter l'application, au moins en partie. Il ne montrait du reste aucune hâte, plein de prudence et de finesse, certain que son jour viendrait, fort de n'être encore compromis dans rien, ayant devant lui le libre espace. Au fond, il n'était qu'un administrateur de premier ordre, d'une éloquence nette et claire, dont le programme ne différait de celui de Barroux que par le rajeunissement des formules, bien qu'un ministère Vignon à la place d'un ministère Barroux apparût comme un événement considérable. Et c'était de Vignon que Sanier écrivait qu'il visait la présidence de la République, quitte à marcher dans le sang pour arriver à l'Élysée. »